







Notes
[*] Cet article est un résumé du mémoire de Master 2 soutenu en juin 2007 à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Robert Frank, dans le cadre du Master d’histoire contemporaine des relations internationales et des mondes étrangers.
[1] Jacques Thobie, Ali et les 40 voleurs, impérialisme et Moyen-Orient de 1914 à nos jours, Paris, Éditions Messidor, 1985, p. 59.
[2] Pierre Milza, Les relations internationales de 1918 à 1939, Paris, Armand Colin, 1995, p. 34.
[3] Auguste Gauvain, « L’accord franco-turc », Journal des Débats, 1er novembre 1921.
[4] « Télégramme du général Gouraud destiné à Aristide Briand, n° 1285/6, daté du 1er octobre 1921 », in Archives diplomatiques du MAE, sous-série Turquie : n° 174, Relations avec la France, 1er octobre 1921 – 10 novembre 1921.
[5] « Lettre adressée par Youssouf Kemal Bey, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale d’Angora à Monsieur Henry Franklin Bouillon à Angora, le 20 octobre 1921 », in Archives diplomatiques du MAE, n° 174, Relations avec la France, 1er octobre 1921 – 10 novembre 1921. Voir annexe n° 13, p. 221.
[6] « Lettre adressée par Youssouf Kemal, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale d’Angora à Henry Franklin Bouillon à Angora, le 20 octobre 1921 », in Archives diplomatiques du MAE, n° 174.
[7] Jacques Bardoux, Lloyd George et la France, Paris, F. Alcan, 1923, p. 250.
[8] Paul du Véou, La passion de la Cilicie : 1919-1922, Chamigny, le Cercle d’écrits caucasiens, 2004 (1re éd. 1937), p. 289.
[9] G. Hervé, « La Dispute franco-britannique », La Victoire, 12 novembre 1921.
[10] H. de Grandvelle, « Vers la paix en Cilicie », Le Gaulois, 6 août 1921.
[11] Michel Paillarès, Le kémalisme devant les Alliés : l’entrée en scène du kémalisme, le traité de Sèvres, l’accord d’Angora, vers la paix d’Orient, Constantinople, Éditions du Bosphore ; Chamigny, le Cercle d’écrits caucasiens, 2005 (1re éd. 1922), p. 55.
[12] George Horton, The Blight of Asia : an Account of the Systematic Extermination of Christian Populations by the Mohammedians and of the Culpability of Certain Great Powers, Athens, Society for the Study of Greek History, 2001 (1re éd. 1926), p. 95.
[13] « Télégramme de la chambre de commerce française de Constantinople au Président du Conseil. Novembre 1922 », in Archives diplomatiques du MAE, n° 182, Excès turcs à l’égard de Français ou protégés français, octobre-novembre 1922.
[14] « Télégramme du général Gouraud n° 416. Envoyé depuis Beyrouth le 28 mai 1922 » ; in Archives militaires du SHAT, Carton 7 N 3217, Télégrammes des Affaires étrangères sur la situation politique en Turquie et les diverses négociations de paix préparatoires à la convention de Moudania et à la conférence de Lausanne (1922).
La guerre et le paix entre la France et la Turquie
[1919-1922]
Le 11 novembre 1918, le grand conflit mondial s’achève. Pourtant le sang coule toujours au Proche et Moyen-Orient, où insurrection nationale et luttes révolutionnaires prolongent la guerre. En mai 1916, avant même d’avoir gagné la guerre, les Alliés divisent « l’Homme malade de l’Europe » en zones d’influences. Les accords Sykes-Picot prennent prétexte des traditionnels intérêts économique et culturel français au Liban, en Syrie ainsi qu’en Cilicie, pour placer ces régions sous mandat français. Le Moyen-Orient est démantelé en cinq zones. La Grande-Bretagne obtient la Palestine et la Mésopotamie et une sorte de protectorat sur l’Iran. Dès 1919, la réaction nationale turque est menée par Mustafa Kemal contre les ambitions des puissances européennes, et la signature du traité de Sèvres qui démantèle l’Empire Ottoman, permet à différentes nationalités d’accéder à l’indépendance. La France rencontre des difficultés dans la zone de son mandat, face à Kemal en Cilicie et face à Fayçal qui se proclame roi de Syrie et rejette le mandat français engageant la France dans de nouveaux affrontements. Cette guerre franco-kémaliste devient de plus en plus onéreuse pour les contribuables français. En 1921 se créent des conditions favorables pour mener des pourparlers directs avec les kémalistes, et le gouvernement français évite de leur attribuer un caractère officiel, afin de ne pouvoir être accusé de séparatisme par ses Alliés.
2
C’est dans ce contexte troublé que se pose notre sujet. Il aborde les relations entre la France et la Turquie kémaliste à l’occasion de l’accord d’Angora du 20 octobre 1921, dont les modalités sont détaillées, tant au niveau de la diplomatie qu’à l’échelon des populations concernées. Les axes de ce travail concernent la politique extérieure de la France à l’égard de la Turquie. Il a semblé intéressant d’élaborer une réflexion sur la mutation de la politique extérieure entre ces deux pays, sur les relations intergouvernementales entre une France affaiblie par la guerre et une Turquie kémaliste naissante, et enfin sur les phénomènes d’opinion. Un cadre chronologique précis peut être fixé à partir du traité de Sèvres en août 1920 jusqu’à la signature du traité de Lausanne en juillet 1923. En effet, le traité de Sèvres met fin à l’intégrité de la Turquie et soulève l’indignation de la population qui se tourne vers les nationalistes. Le traité de Lausanne illustre, lui, la victoire kémaliste – puisqu’il reconnaît la Turquie comme une puissance souveraine désormais habitée par une majorité turque. Plusieurs sources ont été consultées, la plus importante étant celle du ministère des Affaires étrangères au Quai d’Orsay. À cela se sont ajoutées l’analyse de la presse française et britannique, ainsi que celle des matériaux des archives du ministère de la Guerre. Notre étude s’appuie également sur des ouvrages contemporains des faits relatés, qui présentent les coulisses de la scène internationale des années 1920.
Les enjeux de cette recherche sont multiples : étudier la valeur de la presse, dénoncer les failles de la diplomatie française dans un accord concernant des possessions en Orient – chèrement acquises, exposer les manquements de la France. L’injustice profonde vue dans le retrait des troupes françaises d’une Cilicie réellement francophile, engendre un sentiment d’abandon qui s’illustre par des exodes en masse. En effet, cette étude met en perspective le désengagement de la France au Proche-Orient suite à l’accord d’Angora. Toutefois, la finalité majeure réside dans le fait d’éclairer un moment particulier de l’entre-deux-guerres, occulté par les relations conflictuelles avec l’Allemagne. Le mythe d’une France forte et victorieuse est confronté à la réalité d’après-guerre. Focalisée sur sa politique intérieure, la France n’aspire qu’à se reconstruire et à trouver la paix, et, par un simple accord diplomatique, elle légitime un gouvernement révolutionnaire non souverain. La portée de l’accord d’Angora est donc considérable puisque c’est sur cette Turquie kémaliste que s’établit la Turquie actuelle. Mais en quoi l’accord d’Angora marque-t-il un tournant dans la politique orientale française ? Et dans quelles mesures la France ne conduit-elle pas une politique de vainqueur face à la Turquie kémaliste ? De quelles façons les événements autour de l’accord d’Angora et de la Turquie kémaliste sont-ils relayés par la presse et ressentis par les Français ?
Les forces en présence
3
L’élément déclencheur du mouvement nationaliste turc réside en partie dans la figure charismatique de Mustapha Kemal. Jeune militaire, sa bravoure à la bataille des Dardanelles contre les forces de l’Entente lui vaut le grade de lieutenant-colonel. Il retire de cette campagne le prestige d’être l’un des rares généraux ottomans vainqueurs de la guerre mondiale. Il est chargé ensuite, par le gouvernement du Sultan, de superviser la démobilisation de l’armée et de contrôler l’administration en Anatolie. Kemal entreprend alors de faire le contraire de ce pourquoi il a été nommé : il rassemble des armes, regroupe des soldats. Il revendique la Turquie pour les Turcs et arbore l’étendard du comité Union et Progrès qui attire les unionistes. C’est à ce moment que se crée un mouvement nationaliste kémaliste, dont l’essor est dû autant à la ténacité des rebelles qu’à leur propagande pour prétendre à la reconquête de la Turquie.
4
Les vainqueurs de la guerre n’adoptent pas une attitude commune face au mouvement nationaliste. Les Britanniques lui sont opposés, mais en sous-estiment longtemps l’importance. Dans la région de Smyrne, les Grecs se heurtent à une résistance armée mal organisée sur laquelle Kemal a beaucoup de mal à établir un contrôle effectif. Les troupes françaises et kémalistes sont en contact en Cilicie, et la situation tourne à l’échec des Français. Paris n’a pas les moyens d’engager une lutte soutenue à la fois contre les Turcs et contre les Syriens, et juge donc préférable de traiter avec Kemal. Au début de 1920, des contacts diplomatiques ont lieu entre les Français et les nationalistes, qui aboutissent à un armistice en mai. De surcroît, une prise de contact officieuse a lieu, que la France dissimule à son allié britannique.
5
Au printemps 1920, le gouvernement britannique veut détruire le mouvement nationaliste, mais l’état de l’opinion publique ne permet guère une intervention militaire d’envergure. La France, qui approche les nationalistes, et l’Italie – qui est leur alliée non déclarée –, ne sont pas prêtes non plus à s’engager dans une telle entreprise. Reste la Grèce, principale bénéficiaire du traité de Sèvres. Son Premier ministre Venizelos veut créer une « Grande Grèce », ce qui n’est possible que par la défaite du nationalisme turc. Encouragés et soutenus par Lloyd George, et avec l’assentiment du gouvernement français, les Grecs passent à l’offensive. C’est le commencement d’une guerre entre Grecs et Turcs qui va durer plus de deux ans.
Face aux difficultés grecques, une intervention militaire des Alliés est préconisée par les militaires. Toutefois, la solution que les puissances requièrent est celle de la médiation à la conférence de Londres de février-mars 1921. Mais c’est un échec, et les Alliés déclarent qu’ils maintiendront une politique de neutralité entre les combattants, bien que les Grecs protègent les intérêts des Alliés. Les Grecs battus et les Anglais isolés se résolvent à traiter par l’armistice de Moudania, le 11 octobre 1922. L’armée turque fixe alors les conditions de la cohabitation des forces alliées et des nationalistes turcs dans la zone des détroits, et prévoit la convocation d’une conférence de la paix. Athènes renonce donc à la Thrace orientale et Londres s’engage à évacuer Constantinople [1]
[1] Jacques Thobie, Ali et les 40 voleurs, impérialisme...
. Kemal acquiert un pouvoir quasiment absolu dans le nouvel État turc. Le 23 juillet 1919, il préside un congrès nationaliste à Erzeroum où l’on proclame, face à une Porte impuissante et à une Entente désunie, les revendications qui constituent le Pacte national. Il définit les objectifs du mouvement nationaliste : tout d’abord, l’indépendance des territoires turcs ; ensuite, la lutte contre l’occupation et l’intervention étrangère, ainsi que la création d’un gouvernement provisoire pour défendre l’indépendance de la patrie. Le sultan exige le retour de Kemal à Istanbul. Devant son refus, la Porte ordonne son arrestation, mais sans succès. Kemal réunit alors tous les représentants de la Turquie dans un second congrès nationaliste, à Sivas, le 4 septembre 1919. Le Pacte national y est confirmé et Kemal est élu président. Pour tenter une conciliation avec les nationalistes, le sultan annonce des élections qui remplaceront le Parlement, dissout en novembre 1918. Finalement, le nouveau Parlement – à majorité nationaliste – adopte le Pacte national en janvier 1920.
Un accord dicté par les vaincus
6
Du côté français, un armistice franco-kémaliste est conclu pour mettre fin aux attaques kémalistes en Cilicie, alors sous protection française. Mais très vite, les kémalistes ne respectent pas leur parole et amplifient les affrontements. Même si l’on considère au sortir de la Grande Guerre que la France possède la « plus forte armée du monde » [2]
[2] Pierre Milza, Les relations internationales de 1918...
, le pays est très affaibli. La France envisage avec crainte un renouvellement des opérations militaires en Cilicie qui lui ont d’ores et déjà causé beaucoup de pertes, sur les plans financier et humain. Aristide Briand choisit donc d’entamer officieusement des négociations avec Angora. Sans rien dévoiler de son projet à la Grande-Bretagne, le président du Conseil confie cette délicate mission à Henry Franklin Bouillon. Du côté turc, il faut souligner avec quelle habileté les négociations d’Angora sont menées par la Turquie. La figure charismatique de Mustapha Kemal, qui dirige lui-même les pourparlers, influe sur l’accord d’Angora. Mais l’envoi de Franklin Bouillon – un ancien député sans expérience diplomatique – pour négocier un accord qui doit amorcer la pacification de l’Orient et rétablir les relations avec la Turquie fait l’objet d’une forte polémique. Subjugué par le mouvement nationaliste et son leader, il accepte toutes les exigences turques sans obtenir la concrétisation des requêtes françaises, mettant ainsi la France dans une position modeste et déférente, ce qui permet au leader kémaliste de prendre l’ascendant.
7
Dans l’ensemble, les Turcs sont gagnants. Ils obtiennent le départ des troupes françaises de Cilicie et la cessation de l’état de guerre. Les prisonniers respectifs sont immédiatement remis en liberté et amnistiés. Néanmoins, les kémalistes refusent l’amnistie pour les Turcs musulmans qui ont collaboré avec la France. Le Journal des Débats souligne que « la France fait seule des concessions » [3]
[3] Auguste Gauvain, « L’accord franco-turc », Journal...
. La France renonce effectivement au désarmement des populations et des bandes, ainsi qu’à la constitution d’une force de police turque assistée par des officiers français. Le général Henri Gouraud dénonce le fait que cette convention ne prévoit pas « la présence de quelques officiers français dans la gendarmerie chargée de maintenir l’ordre dans les territoires devant revenir à la Turquie » [4]
[4] « Télégramme du général Gouraud destiné à Aristide...
. Certes. Mais en préparant l’évacuation de la riche et stratégique Cilicie, le gouvernement répond aux vœux de nombreux Français qui souhaitent le retour des soldats au pays.
8
En échange de ses abandons, la France décroche un lot substantiel de consolation : l’établissement d’un « régime administratif spécial » pour la région d’Alexandrette, et un transfert de la ligne de chemin de fer de Bozanti-Nousseibine pour un groupe de financiers désigné par Paris. Une série de lettres complémentaires à l’accord sont jointes. D’abord destinée à rester secrète, la liste est finalement communiquée à Lord Curzon le 8 décembre 1921, sur une demande de Londres. Dans l’une d’elles [5]
[5] « Lettre adressée par Youssouf Kemal Bey, ministre...
, le ministre des Affaires étrangères d’Angora, Youssouf Kemal bey, déclare qu’il est disposé à accorder la concession des mines de fer à un groupe français pour une durée de cinq ans, sans spécifier toutefois, qu’une zone serait réservée à cet effet. De plus, il engage également par cette lettre son gouvernement à examiner d’autres demandes qui pourraient être formulées par les groupes français, relatives à la concession de mines, voies ferrées et ports réciproques de la Turquie et de la France [6]
[6] « Lettre adressée par Youssouf Kemal, ministre des...
. Ces promesses ont pour but de faciliter le développement des intérêts bilatéraux entre la France et la Turquie. Du point de vue kémaliste, l’accord d’Angora est un important succès diplomatique car il comporte des avantages immédiats pour la Turquie. Mais il marque également une rupture du front allié contre les kémalistes, et il implique une reconnaissance officielle du nouvel État.
La Grande-Bretagne interroge de nouveau le gouvernement français concernant la mission française, et la France l’assure du fait qu’il n’est pas question pour elle de résoudre avec le gouvernement d’Angora, les questions relatives à la paix qui sont uniquement du ressort des Alliés. L’accord franco-turc est pourtant signé. Le Foreign Office prétend que cette promesse est inconciliable avec un traité qui équivaut à une reconnaissance du gouvernement kémaliste et avec l’engagement de soutenir les revendications turques [7]
[7] Jacques Bardoux, Lloyd George et la France, Paris,...
. L’unité de l’Entente est mise à l’épreuve. Le Gouvernement de Sa Majesté est furieux, il voit dans l’accord d’Angora une paix séparée contraire au pacte signé par les Alliés en novembre 1915, qui leur interdisait de contracter des accords sans se consulter mutuellement. Il estime, en outre, que l’initiative de la France compromet gravement les chances d’une issue favorable aux intérêts des puissances quant au règlement d’ensemble de la question d’Orient. En ce sens, Lord Curzon remet au comte de Saint Aulaire, ambassadeur de France à Londres, un aide-mémoire [8]
[8] Paul du Véou, La passion de la Cilicie : 1919-1922,...
protestant contre la conclusion, par le gouvernement français, de l’accord avec « l’un des ennemis communs des Alliés ». Il est reproché à la France d’avoir leurré le gouvernement britannique par les assurances qui avaient été données sur la mission de Franklin Bouillon. De plus, l’Angleterre juge que l’accord conclu n’a pas le caractère d’un armistice local, mais au contraire celui d’un établissement de la paix entre la France et la Turquie kémaliste. Par conséquent, le gouvernement français entreprend ici une opération diplomatique de caractère séparatiste. En concluant le traité en question, la France reconnaît le gouvernement d’Ankara comme étant souverain de la Turquie.
Enfin, la Grande-Bretagne considère que la France modifie sensiblement les conditions prévues par le traité de Sèvres concernant la frontière septentrionale de la Syrie. Cette révision ne peut pas être envisagée comme une question d’intérêt exclusivement français. Elle rend à la Turquie la Cilicie, un grand territoire fertile qui constituait le gage commun de la victoire des Alliés, bien que le mandat ait été accordé à la France. La restitution des localités de Nousseïbine à la Turquie porte également un grand coup aux intérêts britanniques. L’Angleterre rappelle également que les droits des minorités en Cilicie ne sont pas garantis.
Le regard de la presse et des Français sur l’accord d’Angora
9
L’analyse des réactions de la presse au sujet de l’accord d’Angora montre une attitude française mitigée, même si la majeure partie des journaux français applaudit la réalisation de l’accord, influençant ainsi l’opinion des lecteurs. En revanche, la presse anglaise fait corps avec son gouvernement dans la dénonciation de l’accord d’Angora. La comparaison des quotidiens français et britanniques fait apparaître les carences des journaux français sur le plan de la politique étrangère. Sans service d’information et se contentant de relayer les informations de Londres ou de New York, la presse française est relativement mal informée, une insuffisance qui la dessert puisque cela l’empêche de saisir le problème oriental dans toute sa complexité.
10
La question d’Orient est en effet mal connue du public français. Pourtant le personnage de Mustapha Kemal fascine nombre de journaux et d’intellectuels, occasionnant une peinture souvent exagérée de l’engouement de la population turque pour le mouvement nationaliste. On peut ainsi lire dans le journal La Victoire : « la Turquie à l’heure actuelle c’est Kemal Pacha » [9]
[9] G. Hervé, « La Dispute franco-britannique », La Victoire,...
. Or ceci ne peut être exact puisque l’Empire ottoman en déclin voit sa population se déchirer dans une guerre civile opposant les nationalistes aux partisans du Sultan et du Califat. Néanmoins, certains journaux français fournissent une information objective et détaillée et abordent ce mouvement avec plus de distance et de discernement. On apprend alors que : « le nombre des désertions dans l’armée turque est considérable » [10]
[10] H. de Grandvelle, « Vers la paix en Cilicie », Le Gaulois,...
. Peu de journaux français mentionnent le fait que Kemal tyrannise le peuple turc, las des taxations et des réquisitions arbitraires accompagnées de pillages et de viols. Face à cette politique despotique, le peuple commence à se soulever contre le joug des bandes nationalistes [11]
[11] Michel Paillarès, Le kémalisme devant les Alliés :...
. Cette réalité n’est que très peu abordée par la presse française et seuls quelques journalistes de La Victoire, du Gaulois ou encore du Journal de Genève pallient alors les carences du journalisme français. En signalant les nombreuses erreurs françaises en Orient, ils mettent en exergue les méandres de la diplomatie. Malgré la dénonciation de la réalité faite par les journaux, les multiples prises de position en faveur du mouvement kémaliste, dans la presse et les ouvrages, vont avoir une répercussion évidente sur les Français. Car la question d’Orient est d’une extrême gravité, mais le public français ne s’en aperçoit pas.
Les suites de l’accord
11
Abordant les conséquences de l’accord sur les populations autochtones, nous avons tenté d’en prendre la mesure sur la minorité arménienne, dont le sort est intimement lié à celui de la Cilicie. L’étude des ressorts du désengagement français en Cilicie a mis en au prix du massacre des Arméniens et des Assyro-Chaldéens, de l’émigration des Grecs et de l’assimilation plus ou moins forcée des Kurdes, que lumière la superposition de plusieurs phénomènes. Tout d’abord, la France n’honore pas son engagement de puissance mandataire en abandonnant la protection des minorités de Cilicie. Des décennies de construction de l’influence française au Levant, grâce à l’appui des minorités chrétiennes, sont annihilées puisque la France espère trouver un relais de son influence plus déterminant dans le gouvernement kémaliste. De plus, après une campagne sanglante, la cession de la Cilicie passe pour une victoire à la Pyrrhus aux yeux des militaires français. Ces derniers sont conscients de l’engagement des habitants dont beaucoup se sont enrôlés volontairement dans l’armée française pour former la Légion d’Orient. Mais l’abandon de la France amène les Ciliciens à émigrer, ce qui profite au nationalisme kémaliste. En effet, les kémalistes accélèrent le départ des minorités chrétiennes, par des menaces, des exactions et dépouillent les minorités grecques et arméniennes de leurs biens conservés dans des banques françaises. C’est Mustapha Kemal réalise un État national homogène où les Turcs n’ont jamais constitué une majorité ethnique. La catastrophe de Smyrne permet à Mustapha Kemal de parfaire l’épuration ethnique entamée par le comité Union et Progrès en 1915. Après l’effondrement militaire de l’armée grecque, la ville de Smyrne est prise par les forces kémalistes le 9 septembre 1922. Le 13 septembre, un incendie éclate dans le quartier arménien. Il détruit presque toute la ville faisant près de 100 000 morts. Les troupes régulières de l’armée kémaliste et des civils turcs se livrent aux pillages et massacrent les populations grecque et arménienne. Les témoins français et britanniques rapportent des scènes d’horreur. Pourtant, les navires européens refusent les réfugiés qui tentent de les accoster, et les efforts du consul américain Horton pour organiser l’évacuation sont désavouées par son gouvernement [12]
[12] George Horton, The Blight of Asia : an Account of the...
. Par la suite, Kemal encourage les derniers survivants à l’exil après les avoir spoliés de leurs biens, pourtant à l’abri des banques françaises.
12
Ainsi, la France de l’entre-deux-guerres se comporte tel un Janus politique en présentant deux visages différents, en Europe et au Levant. Elle se montre ainsi extrêmement dure envers l’Allemagne en lui imposant la « paix dictée » du traité de Versailles, ainsi que de lourdes réparations. En 1921, la Turquie fait elle aussi partie du camp des vaincus, mais c’est dans un climat de grande sympathie que la France mène l’accord d’Angora. Nous avons d’ailleurs observé que non seulement les clauses de l’accord favorisent davantage Angora, mais aussi que la France apporte une légitimité au gouvernement dissident. Enfin, elle se contente de quelques engagements, promettant un avenir culturel et commercial français en Turquie, qui ne seront pas honorés par le gouvernement kémaliste.
13
En permettant la concrétisation de la révolution kémaliste, la France a fait plus que légitimer ce gouvernement. En effet, dès que le mouvement nationaliste se trouve en difficulté, les généraux français qui veulent l’attaquer et l’anéantir, ne trouvent ni l’appui des diplomates, ni celui des politiques. En 1918, les Turcs étant « craintifs et soumis », il était alors possible d’organiser le pays sur des bases « favorables aux Alliés » [13]
[13] « Télégramme de la chambre de commerce française de...
. Selon les militaires, la France déclare trop ouvertement qu’elle ne combattra jamais les Turcs et elle perd alors tout prestige. En d’autres termes, l’indulgence française est appréhendée comme une politique d’abdication et de faiblesse, qui dessert ses véritables intérêts. Manifestement, la France n’a donc pas mené une politique de vainqueur face au mouvement nationaliste.
14
C’est également sur les dissensions des Alliés que le kémalisme a pu prendre son essor et s’épanouir. On peut aisément imaginer que si l’entente franco-britannique avait été réelle, elle aurait soutenu la Grèce et dépecé l’Empire ottoman. Mais la France choisit d’encourager l’orgueil turc en se pliant aux exigences kémalistes, et elle devient le fournisseur d’armes et de matériel de guerre d’Angora, à titre gracieux. C’est pourquoi le paradoxe est patent lorsqu’en 1922, la France devient la cible de cet orgueil qu’elle a contribué à galvaniser. L’insuccès de l’accord est évident du point de vue français, et ceci seulement un an après sa signature. Le partenariat économique promis par les Turcs ne s’est pas concrétisé. De surcroît, non contente de ne pas honorer les termes de son accord avec la France, la Turquie lui crée des difficultés dans le mandat syrien. À Damas, les Turcs tentent d’exacerber l’opinion grâce à une propagande encourageant les Syriens à la révolte [14]
[14] « Télégramme du général Gouraud n° 416. Envoyé depuis...
.
15
Les renoncements français amènent à penser que l’accord d’Angora fait partie d’une sorte de répétition générale au traité de Lausanne, qui enterre définitivement le traité de Sèvres. Signé en 1920 par la Turquie, ce dernier est annulé par le traité de Lausanne du 24 juillet 1923. Il règle l’ensemble du contentieux international de la Turquie, qu’il résulte de la guerre mondiale ou de la guerre gréco-turque. La nouvelle Turquie y reçoit sa consécration internationale. Ses forces militaires ne sont plus limitées, les Capitulations sont abolies. Le traité sanctionne la défaite militaire grecque en Asie Mineure et concède à la Turquie kémaliste la totalité de l’Anatolie, la Thrace orientale, ainsi qu’un territoire de 23 000 km2 en Europe. Ce traité est donc très différent de ceux qui ont été imposés par les vainqueurs aux vaincus de la Première Guerre mondiale. Le résultat immédiat et concret de la conférence est la convention bilatérale, qui prévoit un échange de populations entre la Turquie et la Grèce. Pour la première fois de son histoire, l’Asie Mineure devient homogène.
En outre, la conférence de Lausanne voit l’abandon définitif de la question arménienne. Winston Churchill écrit dans ses mémoires : « Dans le traité de Lausanne qui rétablit l’état de paix entre la Turquie et les alliés, l’Histoire cherchera en vain le mot d’Arménie ». Le traité acceptait tacitement les faits de guerre : le génocide des Arméniens, le massacre des Assyriens, la déportation de Kurdes et l’expulsion des Gréco-orthodoxes commise au profit de la turquification de l’Anatolie. Le nouveau gouvernement d’Ankara cachait à peine sa naissance au sein du parti jeune-turc responsable des crimes perpétrés entre 1914-1918. L’homogénéisation en germe depuis la révolution jeune-turque est parachevée par le gouvernement nationaliste. Après onze années de guerre, la population a diminué de trois à six millions d’habitants musulmans, arméniens, grecs – tués, chassés ou en fuite. Les réfugiés arméniens deviennent des « apatrides », la diaspora vient de naître.
À la suite du traité de Lausanne, la nouvelle Turquie est admise dans le concert des nations. En octobre 1923, elle devient une république autoritaire et son président Kemal est investi de la totalité du pouvoir exécutif. Il utilise l’immense puissance que lui vaut son rôle de libérateur de la patrie pour entreprendre des réformes de la société turque. En novembre 1922, il avait décidé l’abolition du Sultanat. Il continue son œuvre par l’abolition du Califat qu’il fait voter par les députés en mars 1924. Il réforme l’éducation et propose une révolution linguistique, juridique, économique, dans le but de faire de la Turquie un État moderne sur le modèle occidental. La turquisation des noms de villes participe au processus nationaliste de renouveau : Angora devient donc Ankara où est transférée la capitale, pour l’ancrer en Anatolie, berceau nationaliste.
Au lendemain de la Grande Guerre, les relations internationales se modifient : les acteurs changent, les territoires également. Sur les ruines de l’Empire ottoman, la formation d’une Turquie kémaliste directe héritière du régime jeune-turc constitue l’un des événements majeurs de l’histoire du Proche-Orient au XXe siècle. L’étude de cette période semble tout à fait pertinente au moment où la Turquie fait valoir sa demande d’adhésion à l’Union européenne, en brandissant l’étendard d’un héritage kémaliste et laïc. L’ombre du général Mustapha Kemal plane donc encore sur la Turquie du XXIe siècle, et l’armée reste la garante de ce précieux legs. Cependant, certaines tensions issues de cette période persistent encore et handicapent les rapports de la Turquie avec certains pays. Le blocus qu’elle fait peser sur la république d’Arménie et le négationnisme d’état concernant le génocide des Arméniens, restent autant de questions qui compliquent les relations internationales et la paix dans cette région.


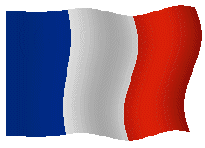

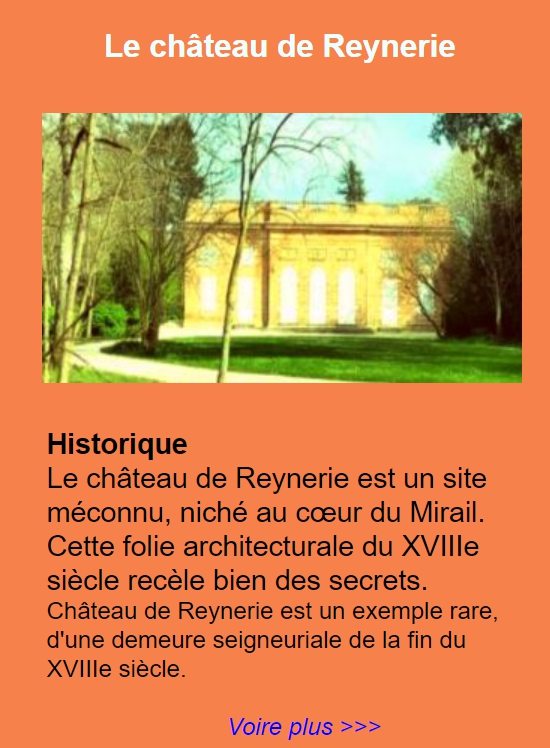

Polygone.info fait des émissions sur internet, laïque, démocratique et apolitique. Leurs émissions a pour objectif de promouvoir l’amitié entre les Turcs et les Français, de favoriser les liens entre les deux communautés, les deux pays, en organisant des activités et des rencontres : culturelles, sociales, amicales et récréatives.